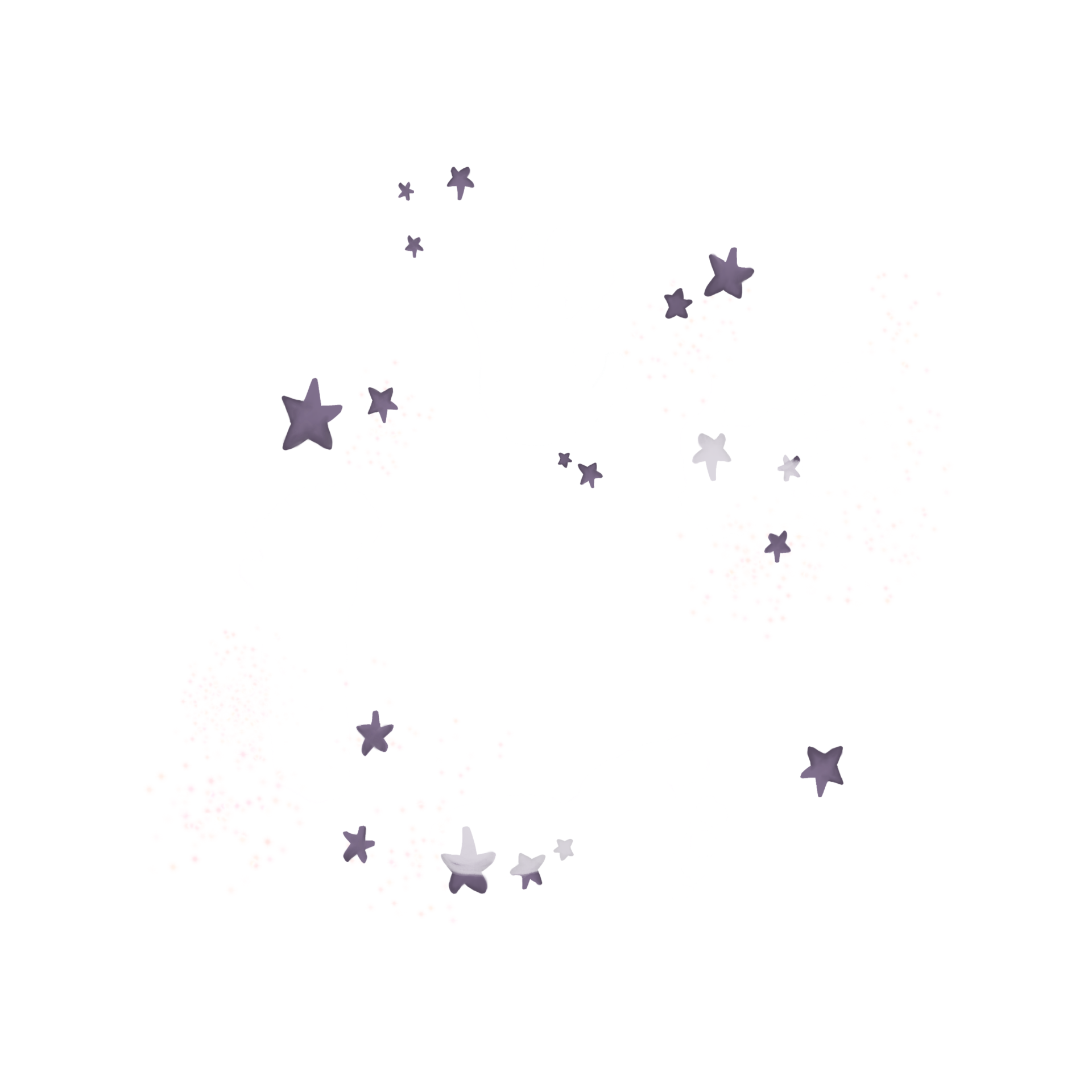fonctionnelle ou relationnelle ?
Dans les pratiques de soin faisant référence au développement psychomoteur, on peut observer des méthodes variées, souvent appelées « psychomotricité fonctionnelle » ou « psychomotricité relationnelle ». La distinction de ces deux termes est toute relative, car le psychomotricien travaille par définition la fonction dans la relation et vis versa.
Pour faire simple (au risque de réduire à des généralités, mais par soucis de faciliter la compréhension), cela peut s'expliquer historiquement. En effet, avant l'apparition en Belgique du bachelier en psychomotricité , les psychomotriciens étaient généralement préalablement formés soit dans un métier paramédical de type kiné, ergothérapeute, logopède, ..., et pratiquaient généralement une approche plutôt à orientation fonctionnelle et dite "directive", visant la récupération, le développement ou la compensation d’une fonction motrice déficitaire. D'autres étaient formés préalablement dans un métier orienté santé mentale, comme psychologue. La pratique psychomotrice était alors envisagée plutôt dans ses liens avec le développement psycho-affectif et relationnel, et proposée dans un cadre de mise en jeu souvent dit "libre".
Actuellement le métier tend à mieux définir les concepts qui sous-tendent sa pratique, qui non seulement tient compte des composantes fonctionnelles, relationnelles, psychoaffectives et cognitives du corps en mouvement , mais tend à les relier. C'est dans cette interaction que le psychomotricien travaillera, dans un concept de "dynamique psychomotrice", qui dépasse la seule somme de ses fonctions.